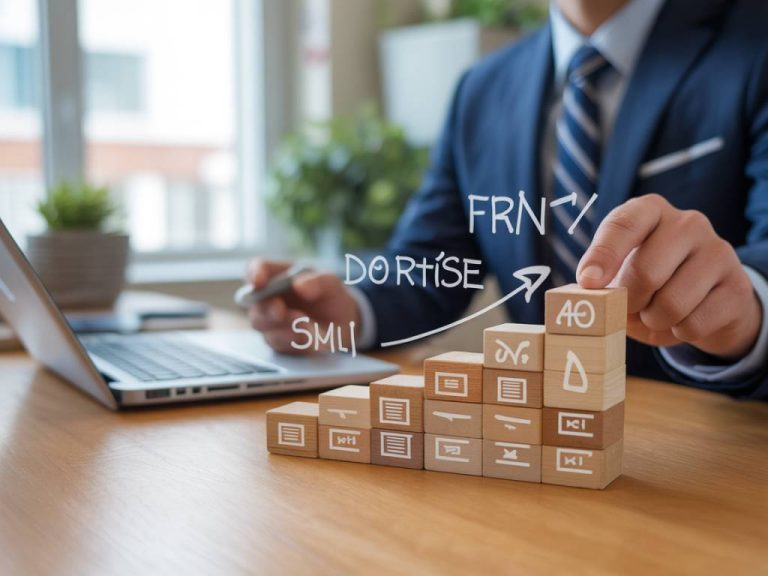Professions libérales : de qui parle-t-on vraiment ?
On met souvent tout et n’importe quoi dans la case « profession libérale ». Pourtant, derrière ce terme se cachent des réalités très différentes… et des enjeux de protection sociale et d’épargne qui n’ont rien à voir avec ceux des salariés.
En droit français, une profession libérale désigne une activité exercée de manière indépendante, fondée principalement sur des prestations intellectuelles, techniques ou de soins, avec une responsabilité personnelle et une certaine autonomie dans l’organisation du travail.
On distingue deux grandes familles :
- Les professions libérales réglementées
- Les professions libérales non réglementées (souvent appelées « libérales non réglementées » ou « freelances » dans le langage courant)
Pourquoi cette distinction est essentielle pour votre épargne et votre protection sociale ? Parce qu’elle conditionne votre régime de retraite, vos cotisations, vos droits en cas d’arrêt de travail… et donc la stratégie financière à mettre en place.
Liste des professions libérales réglementées
Les professions libérales réglementées sont encadrées par un ordre professionnel, un code de déontologie, des conditions d’accès (diplômes, expérience, inscription à un ordre, etc.). Voici les principales :
- Professions de santé :
- Médecins (généralistes et spécialistes)
- Chirurgiens-dentistes
- Sages-femmes
- Pharmaciens titulaires d’officine
- Infirmiers et infirmières libéraux
- Masseurs-kinésithérapeutes
- Orthophonistes, orthoptistes
- Podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, etc.
- Professions juridiques et judiciaires :
- Avocats
- Notaires
- Huissiers de justice (devenus commissaires de justice)
- Administrateurs et mandataires judiciaires
- Greffiers de tribunaux de commerce
- Professions du chiffre :
- Experts-comptables
- Commissaires aux comptes
- Professions techniques réglementées :
- Architectes
- Géomètres-experts
Ces professions disposent souvent de caisses de retraite spécifiques (CARMF pour certains médecins, CARPIMKO pour paramédicaux, CNBF pour les avocats, etc.), avec des règles propres. Et c’est là que les choses se compliquent…
Liste des professions libérales non réglementées
À côté des professions encadrées, on trouve une galaxie de métiers intellectuels ou de services exercés en indépendant, sans ordre professionnel. Quelques exemples concrets :
- Conseil et accompagnement :
- Consultants en stratégie, organisation, RH, finance
- Coachs (business, carrière, développement personnel)
- Formateurs indépendants
- Numérique, tech, création :
- Développeurs web, data scientists, designers UX/UI
- Graphistes, directeurs artistiques freelances
- Rédacteurs web, copywriters, traducteurs
- Community managers, consultants SEO/SEA
- Experts techniques :
- Ingénieurs-conseils
- Consultants en environnement, RSE, finance durable
- Experts en cybersécurité, en gestion de risques
- Accompagnement et bien-être :
- Psychologues (hors conventionnement), psychothérapeutes
- Diététiciens, naturopathes, ostéopathes non réglementés
- Coach sportifs indépendants (hors structures salariales)
Ces professionnels relèvent en général du régime des travailleurs indépendants (URSSAF, Sécurité sociale des indépendants pour la retraite). Le point commun avec les professions réglementées ? Un niveau de protection sociale de base souvent très insuffisant si on le compare à celui d’un salarié cadre.
Ce qui change vraiment par rapport à un salarié
Exercer en libéral, c’est accepter (ou subir) trois grandes différences majeures sur le plan social et financier :
- Une retraite de base plus faible : les taux de cotisation sont souvent plus bas qu’en salariat… donc les pensions aussi. Pour un même revenu net, la retraite peut être amputée de 20 à 40 % par rapport à un salarié cadre, selon les professions et les carrières.
- Une protection prévoyance minimale : en cas d’arrêt de travail, l’indemnisation est limitée, parfois inexistante sur les premiers jours (franchise longue), et très loin de votre dernier revenu. En cas d’invalidité ou de décès, le « filet de sécurité » peut être ridiculement bas.
- Une instabilité de revenu structurelle : cycles d’activité, impayés clients, maladies, congé maternité/paternité… Votre chiffre d’affaires n’est pas linéaire, vos charges fixes, si.
Autrement dit : la liberté et le potentiel de rémunération plus élevé des professions libérales s’échangent contre un risque personnel plus important. La bonne nouvelle, c’est qu’une partie de ce risque peut être gérée par une stratégie d’épargne et de protection sociale pensée dès le départ.
Les angles morts fréquents des professions libérales
Sur le terrain, on retrouve presque toujours les mêmes biais financiers chez les libéraux :
- Surestimation de la future retraite : « Avec ce que je gagne, ça ira ». Non, pas sans effort d’épargne significatif. Les projections des caisses sont souvent un électrochoc quand elles sont enfin demandées.
- Équipement tardif en prévoyance : tant qu’on n’a pas eu un gros pépin de santé autour de soi, la couverture arrêt de travail / invalidité reste un sujet « à voir plus tard ».
- Confusion entre trésorerie pro et patrimoine perso : beaucoup de libéraux considèrent leur compte professionnel comme une « épargne » de fait. Or ce n’est ni diversifié, ni protégé, ni liquide en cas de coup dur prolongé.
- Sous-usage des enveloppes fiscales adaptées : PER individuel, ancien contrat Madelin, épargne salariale dans certains montages… souvent méconnus ou mal utilisés.
L’objectif n’est pas de vous transformer en actuaire, mais de vous donner un cadre opérationnel pour couvrir les trois grands risques : revenu interrompu, longévité (vivre vieux… sans ressources suffisantes), et incapacité de travail.
Protection sociale : les priorités pour un libéral
Avant de parler optimisation fiscale ou investissement responsable, la base, c’est la protection du « capital humain » : votre capacité à travailler. Trois briques sont à regarder en priorité.
1. L’arrêt de travail et l’invalidité
Question simple à vous poser : si vous ne pouviez plus travailler pendant 6, 12, 24 mois, quelle serait la chute de revenu réelle, et combien de temps pourriez-vous tenir avec votre épargne actuelle ?
Pour beaucoup de professions libérales, la réponse objective est : « quelques mois au mieux ».
D’où l’intérêt d’un contrat de prévoyance adapté :
- Prise en charge d’un revenu de remplacement cohérent avec votre niveau de vie
- Franchise (délai de carence) compatible avec votre épargne de précaution
- Définition de l’invalidité « professionnelle » (sur votre métier) et non pas seulement « toute profession »
- Possibilité d’indexation des rentes dans le temps
Côté finance durable, certains assureurs commencent à proposer des contrats de prévoyance couplés à des supports d’épargne investis avec des critères ESG ou à impact, notamment pour les options d’épargne associées.
2. Le décès et la protection de la famille
Pour les professions libérales qui ont des enfants, des associés, des prêts personnels ou professionnels, une assurance décès adaptée n’est pas un luxe, c’est un amortisseur de choc.
Les points à regarder :
- Capital décès suffisant pour solder les prêts et maintenir le niveau de vie des proches
- Clause bénéficiaire bien rédigée (pour éviter des blocages successoraux)
- Couverture des associés (cross-assurance) pour rachat de parts en cas de décès d’un partenaire
Encore une fois, ce n’est pas le produit le plus « sexy », mais c’est celui qui évite de transformer un drame humain en drame financier.
3. La santé et la maternité/paternité
La complémentaire santé reste fondamentale, surtout pour certaines professions de santé ou physiques. À regarder notamment :
- Niveaux de prise en charge en hospitalisation
- Garanties spécifiques (optique, dentaire, médecines douces si vous y avez recours)
- Indemnités journalières complémentaires pour maternité/paternité ou arrêt de travail court
Ce socle de protection est la « ceinture de sécurité » de votre stratégie patrimoniale. Une fois solidifié, on peut parler épargne, retraite, investissement… y compris à impact.
Construire sa retraite quand on est en libéral
Pour la retraite d’un libéral, trois règles simples :
- Ne pas compter uniquement sur les régimes obligatoires
- Commencer tôt, même avec de petites sommes
- Diversifier les supports et les enveloppes fiscales
1. Comprendre ce que vous aurez réellement
Première étape très pragmatique : demander une estimation de droits à vos caisses (de base + complémentaires) et réaliser des simulations avec différents niveaux de revenus et de durée de carrière.
Pour un professionnel qui démarre tôt en libéral, il n’est pas rare de constater un taux de remplacement (pension/revenu d’activité) de 30 à 50 % seulement. L’écart doit donc être comblé par :
- Une épargne longue (capitalisation)
- Éventuellement des revenus complémentaires (immobilier locatif, dividendes d’entreprise, etc.)
2. Le PER individuel, outil clé… à manier intelligemment
Le Plan d’Épargne Retraite individuel permet de déduire les versements de votre revenu imposable (dans certaines limites), avec sortie possible en rente et/ou en capital à la retraite.
Intérêt pour les professions libérales :
- Déduction fiscale souvent très intéressante pour les tranches marginales élevées (30 % et plus)
- Souplesse des versements (contrairement à certains anciens contrats Madelin)
- Possibilité de choisir des supports d’investissement responsables, ISR ou à impact
Point de vigilance : l’argent est bloqué jusqu’à la retraite (hors cas de déblocage anticipé). Il ne faut donc pas y mettre toute votre épargne, au risque de manquer de liquidité en cas de problème.
3. Assurance-vie et investissement responsable
L’assurance-vie reste l’enveloppe patrimoniale la plus polyvalente :
- Fiscalité intéressante après 8 ans
- Transmission facilitée (en plus des aspects retraite)
- Accès à une gamme très large de supports, dont des fonds ISR, des fonds à impact, des unités de compte sur des thématiques durables (transition énergétique, santé, inclusion, etc.)
Pour un libéral sensible à l’impact de son épargne, il est aujourd’hui possible de construire un « socle retraite » en combinant :
- Un PER individuel investi à majorité sur des fonds labellisés ISR, Greenfin ou Finansol
- Une ou plusieurs assurances-vie orientées vers des supports à impact (fonds d’infrastructures vertes, obligations vertes, fonds d’entrepreneuriat social, etc.)
Épargne de précaution et indépendance financière
L’épargne de précaution d’un salarié correspond classiquement à 3 à 6 mois de dépenses. Pour une profession libérale, la cible est souvent plus élevée.
Pourquoi viser plutôt 6 à 12 mois ?
- Vos revenus peuvent baisser brutalement (perte de gros clients, congé longue durée, etc.)
- Vos charges professionnelles (loyer, matériel, salaires de collaborateurs) continuent de courir
- Les délais d’indemnisation des assurances et caisses peuvent être longs
Cet « airbag financier » doit rester sur des supports très liquides et sûrs (livrets réglementés, livrets bancaires, fonds monétaires prudents…), quitte à sacrifier un peu de rendement. On ne parle pas ici d’investissement, mais de sécurité.
Une fois ce socle constitué, l’épargne de long terme (retraite, projet immobilier, investissement en entreprises à impact) peut être construite de manière plus ambitieuse.
Intégrer l’investissement responsable dans la stratégie d’un libéral
Les professions libérales, par leur autonomie et leur niveau de revenu souvent supérieur à la moyenne, ont un « pouvoir d’allocation » de capital loin d’être négligeable. Trois pistes concrètes pour aligner vos placements avec vos valeurs :
- Choisir systématiquement des supports responsables dans vos PER et assurance-vie : fonds ISR, fonds thématiques (climat, santé, éducation), obligations vertes, etc.
- Consacrer une part de votre patrimoine financier à l’investissement à impact :
- Fonds solidaires (label Finansol)
- Fonds d’entrepreneuriat social ou d’inclusion
- Plates-formes de financement participatif (equity ou dette) dédiées à la transition écologique et sociale
- Aligner les placements de votre structure professionnelle (trésorerie de société d’exercice libéral, holding, etc.) sur des critères ESG, au lieu de laisser dormir les excédents sur des supports peu transparents.
La clé, comme toujours sur Invest4Good, est de ne pas sacrifier l’exigence financière à l’impact, mais de chercher des combinaisons où les deux se renforcent : entreprises résilientes, modèles durables, risques extra-financiers mieux maîtrisés.
Plan d’action en 7 étapes pour les professions libérales
Pour rendre tout cela opérationnel, voici un chemin en 7 étapes, à adapter à votre situation :
- Étape 1 : Identifier précisément votre statut (réglementé/non réglementé), vos caisses et vos droits sociaux actuels.
- Étape 2 : Faire un bilan de protection sociale (santé, prévoyance, décès) avec des montants chiffrés : que se passe-t-il si vous vous arrêtez de travailler demain ?
- Étape 3 : Constituer ou compléter une épargne de précaution couvrant au minimum 6 mois de dépenses professionnelles + personnelles.
- Étape 4 : Demander des simulations de retraite (régimes obligatoires) et chiffrer l’écart par rapport au revenu que vous visez.
- Étape 5 : Mettre en place une stratégie retraite combinant PER individuel et assurance-vie, avec une allocation progressive vers des supports responsables.
- Étape 6 : Réviser vos contrats de prévoyance et de décès : définitions, franchises, montants. Quitte à les moderniser et les adapter à votre niveau de revenus actuel.
- Étape 7 : Allouer une part (même modeste au départ, 5 à 10 %) de votre patrimoine financier à l’investissement à impact pour tester, apprendre, ajuster.
Exercer en profession libérale, c’est déjà un acte de liberté économique. Structurer sa protection sociale et son épargne, c’est la condition pour que cette liberté ne se transforme pas, un jour, en vulnérabilité subie. Et tant qu’à déployer cet effort, autant en profiter pour orienter votre capital vers les entreprises et projets qui construisent l’économie dont vous avez envie, en tant que citoyen autant que professionnel.